Note : comme l’indique Jean Gillermou dans l’avant-propos de ses mémoires, il a décidé « d’attribuer à presque tous (de ses camarades de guerre) des noms plus ou moins imaginaires ».
*Keren et la brousse
La frontière de l’Erythrée a été franchie sans difficulté : les troupes italiennes, qui comprenaient beaucoup d’Erythréens, se sont repliées, après quelques heures de combat, sur la position forte de Keren.
La Section avance assez facilement, parfois sur des pistes rocailleuses, parfois dans le lit de torrents (à sec en cette saison), et prend position à quelque six kilomètres de Keren. La chaleur est très forte mais sèche, donc très supportable. Peu d’arbres qui donnent de l’ombre sauf en bordure des oueds. Partout des arbustes et des arbres épineux, merveilleuse ressource pour un des sous-offs, qui a réussi à transporter jusqu’à présent un phonographe à manivelle, mais qui n’a guère d’aiguilles d’acier. Les épines se révèlent de très bonnes aiguilles, qui ne risquent pas de rayer les disques : elles s’usent très vite parce qu’elles sont d’un bois très tendre, mais les stocks disponibles sont inépuisables puisqu’il y en a des milliers sur chaque arbre ou arbuste.
Les deux canons et leur caisson sont installés, ce qui ne s’est pas fait sans mal, dans ce sol rocailleux qui ne connaît guère l’horizontale. Pendant quelques jours, c’est un tir de harcèlement : un obus lancé de temps en temps, de jour et de nuit, sur cette petite ville et ses abords immédiats. Une nuit, le A vos postes ! retentit une heure avant l’aube. Et c’est un tir intensif pendant toute la matinée. Puis c’est le silence : l’attaque lancée par les seuls légionnaires (sans la moindre participation de l’aviation britannique, paraît-il) a échoué.
Les tirs de harcèlement reprennent pendant une semaine cependant que chacun s’installe le plus confortablement possible, repérant les arbres relativement ombreux au bord d’un oued. Ce genre de tirs ne réclame guère que la moitié des servants des canons. Les autres s’occupent et se distraient comme ils peuvent, mais, chose curieuse, il y a peu de volontaires pour la corvée de soupe , qui consiste à aller à pied, à environ deux kilomètres en arrière, chercher dans les bouteillons (sortes de marmites hautes mais peu larges) la soupe, le rata , le thé, etc. Bien entendu, il faut tout réchauffer, mais le bois ne manque pas : outre celui que peuvent fournir les arbustes, il y a celui des caisses qui contenaient les obus qu’on a utilisés.
Pour cette corvée, TARIEC, KERAVEL, GALAMIAN et moi, nous sommes toujours volontaires. BEYNAT et CASTELLET le seraient aussi, mais leur spécialisation, de téléphoniste pour le premier et de pointeur pour le second, les rend indisponibles pour ces travaux trop faciles. En général, deux hommes suffisent pour transporter les bouteillons mais aujourd’hui, par téléphone, le cabot-rata , c’est-à-dire le chef de la cuisine, a demandé qu’on prévoie un porteur supplémentaire.
KERVEL, GALAMIAN et moi, nous nous en allons donc ensemble, avec la bénédiction du chef de pièce, et nous nous présentons à la cuisine . Le cabot-rata nous fait remettre, en plus des bouteillons et des biscuits de guerre habituels, un bidon d’huile (d’environ cinq litres) et un petit sac de farine, récupérés , précise-t-il, dans les stocks de l’armée italienne après sa retraite d’un poste-frontière.
A notre retour à la position, nous sommes accueillis par des cris de joie de nos copains. On va pouvoir améliorer un peu le rata avec ça, disent-ils . Ils se préparent donc à verser de l’huile dans le bouteillon du rata, mais dès qu’ils enlèvent le couvercle, ils s’aperçoivent que les cuistots les ont prévenus : tout nage dans un bain d’huile.
Que faire pour utiliser tout cela ? Je propose alors qu’on fasse des sortes de beignets avec la farine. Sans doute…, mais cinq litres d’huile pour trois ou quatre kilos de farine, c’est beaucoup ! Mais, propose-je, si on faisait tremper dans de l’eau ces biscuits incassables qu’on touche chaque jour ? Ils vont se ramollir et ça fera une sorte de pâte, dont on pourra faire des boulettes. Après, on n’aura qu’à les enrober dans un peu de farine avant de les jeter dans de l’huile bouillante.
— Ah ! on voit bien que tu n’es qu’un étudiant, s’écrie CORMEILLES. Un étudiant, ça n’a rien dans la tête et ça ne sait pas quoi faire de ses dix doigts.
CORMEILLES, c’est le chauffeur du tracteur-canon, un soldat de carrière de l’Artillerie coloniale, qui, après quinze années de loyaux services, a fini par être nommé brigadier (grade correspondant à caporal ). Il conduit bien son tracteur, qu’il entretient constamment avec amour, sauf dans les périodes où le vin ou la bière sont trop accessibles. Il sait à peine lire et écrire : les mauvaises langues disent même qu’il ne donne jamais les punitions dont il a menacé ses subordonnés parce que celles-ci requièrent un motif écrit. Comme il n’a pas toujours sous la main un copain gradé qui accepte de rédiger pour lui les quelques lignes indispensables, il préfère, disent-elles, renoncer à flanquer un motif.
Quoi qu’il en soit, il n’aime guère ceux qui ont une certaine instruction et, en particulier, les étudiants, à qui il reproche, à toute occasion, de ne pas savoir quoi faire de leurs dix doigts .
Heureusement le chef de pièce intervient : On peut toujours essayer de faire ces sortes de beignets. D’ailleurs, je ne vois pas comment on pourrait utiliser autrement tous ces biscuits anglais, qui sont encore plus durs que les biscuits de guerre français.
J’ai donc l’aval de mon chef de pièce et je commence à mettre des biscuits à tremper dans de l’eau. Mais aussitôt je me ravise et je propose qu’on utilise une partie du thé une fois qu’il aura été réchauffé. Chacun pense qu’en effet ce serait une bonne utilisation de ce liquide : les cuistots sont toujours très généreux en thé et la plus grande partie de cette boisson, si hygiénique, est donc surtout utilisée pour dégraisser gamelles et bouteillons.
Tout l’après-midi, et la nuit suivante après chaque tir, il se trouvera toujours quelqu’un pour aller voir comment les biscuits s’attendrissent dans leur contact avec le thé. Au matin, ça commence à bien se ramollir et je décide d’aider un peu leur nature. Je malaxe à pleines mains cette sorte de brouet, puis je le transforme en boulettes, que j’enrobe de farine et qu’Yvon KERAVEL lance dans l’huile qu’un autre copain fait bouillir. C’est dommage, dis-je à mes copains, qu’on n’ait pas de réserves de sucre. Ce serait sûrement meilleur . Mais ce ne sont là que paroles pour conjurer le mauvais sort : au fond de moi-même je suis certain que, tels quels, mes beignets ne peuvent manquer d’être, tout bonnement, délicieux.
Après le déjeuner, c’est enfin la distribution des beignets : un vrai triomphe pour moi ! Seul, CORMEILLES refuse d’en manger, tout en grommelant que les étudiants, ça n’a rien dans la tête et ça ne sait pas quoi faire de ses dix doigts .
Le Concubin intervient avec un air candide : Je vous assure, Brigadier, que c’est très bon et, après un clin d’oeil malicieux à ses copains, il ajoute : Et on ne risque pas de se casser les dents. Tous détournent la tête pour que CORMEILLES ne les voie pas rire : il faut dire que ce pauvre brigadier n’a plus guère de dents qui soient immédiatement perceptibles, sauf une à la mâchoire inférieure, qui est bien noire et bien branlante, mais qui semble vouloir respecter les lois de la gravité.
Soudain le Chef de section crie : A vos postes ! Chacun se précipite vers les pièces. Yvon a eu le réflexe d’enlever du feu la marmite pleine d’huile bouillante. C’est en réalité la moitié inférieure d’un de ces bidons en fer blanc que les Anglais utilisent beaucoup pour le transport de l’essence et qu’ils appellent tins . Une centaine d’obus sont envoyés dans la direction de Keren, puis c’est à nouveau le repos. CORMEILLES, en tant que chauffeur, n’a pas à participer aux tirs. Il est donc resté seul dans le coin-cuisine . S’apercevant que l’alerte est terminée, il s’empresse de retourner près de son tracteur, là où se trouve sa tente.
D’un coup d’œil je constate alors que le nombre de beignets a beaucoup diminué, tandis que la nuque chauve de CORMEILLES frémit de contractions qui révèlent une mastication relativement laborieuse.
Désormais ma cote est au plus haut : si je fais mine de vouloir prendre place à côté des munitions quand c’est mon tour de faire le pourvoyeur, le chef de pièce me renvoie aussitôt à ma tin-friteuse . Les jours suivants, les cuistots seront étonnés de constater qu’à chaque corvée-rata nous réclamons une bonne ration supplémentaire de thé et de ces biscuits incassables, mais ils n’en auront l’explication que bien plus tard.
Cette fois, ce n’est plus une attaque improvisée : des avions britanniques sont venus bombarder Keren cependant que nous, les artilleurs, nous continuons à tirer sur la ville et sur ses environs. Le soir, la ville est prise et il y a, dit-on, quantité de prisonniers, surtout des Erythréens bien sûr. Nous n’aurons pas le temps, hélas ! d’aller visiter cette ville car il faut se rendre au plus vite à Massawa, le port qui permet d’approvisionner les Italiens dans toute l’Erythrée. Un jour de repos nous est toutefois accordé dans une oasis, à une vingtaine de kilomètres de là. L’eau n’y coule plus à ciel ouvert, mais, grâce à une magnifique installation de pompage, il y a largement de quoi boire et même se doucher.
Cette station aurait dû sauter : le responsable avait reçu l’ordre de la faire exploser à l’arrivée de l’ ennemi . Mais cet Italien, qui est antifasciste et a précisément été déporté en Erythrée pour cette raison, a choisi de refuser d’exécuter cet ordre. Ayant été réfugié en France pendant une dizaine d’années, il parle parfaitement le français et il nous raconte les persécutions que ce régime lui a fait subir. Malgré cela, on sent bien que ce n’est pas sans hésitation qu’il a pris cette décision… contre des gens de son pays. Ah ! ça coûte cher, conclut-il, l’amour de la liberté.
Pour des raisons qui sont probablement de haute stratégie mais qui sont restées secrètes, KERAVEL BEYNAT et moi, nous avons été invités cette fois à monter dans un camion de munitions, ce qui aurait pu nous coûter la vie : rouler dans un camion-cuisine, cela ne paraît pas (bien à tort d’ailleurs) très glorieux pour des apprentis guerriers, mais c’est plus sûr que d’être dans un camion qui ne contient guère que des munitions et qui peut tomber en panne en plein désert.
Alors que la colonne s’avance aussi rapidement que possible sur une piste rocailleuse, le camion de munitions s’arrête soudain. Le chauffeur soulève le capot, démonte et nettoie le carburateur. Hélas ! le moteur ne veut pas démarrer. Il faut donc attendre qu’arrivé le camion de dépannage, qui roule en queue de tout le convoi. L’attente se fait d’abord paisiblement, mais le second jour, les vivres de route sont épuisés. Au troisième jour, toujours rien à l’horizon… et nous n’avons plus rien à nous mettre sous la dent. BEYNAT, KERAVEL et moi, nous nous déclarons prêts à aller dans les environs immédiats pour tâcher de rapporter du gibier : les pintades sauvages ne manquent pas dans la région. La difficulté, c’est de les atteindre avec des balles de mousqueton, faites pour des cibles plus larges…, un homme par exemple.
Nous nous en allons donc, avec la bénédiction du chef de camion, qui nous demande seulement de revenir dès que nous entendrons un coup de sifflet. Une heure plus tard, KERAVEL aperçoit une masse énorme qui remue sous un grand arbre. Il tire ; la balle va se planter dans l’arbre et la masse s’éloigne. BEYNAT épaule à son tour et appuie sur la gâchette. Rien ne part. KERAVEL prend immédiatement le relais, mais son mousqueton aussi a un raté . La grosse masse continue à s’éloigner. A mon tour, je m’apprête à tirer mais BEYNAT me dit : J’ai l’impression que c’est un sanglier. Il vaut mieux ne pas s’attaquer à de pareilles bêtes avec des cartouches ou des fusils dont on n’est pas sûr. Si on blesse un sanglier, il va foncer sur nous et…
Aussitôt nous nous mettons tous trois à examiner les deux mousquetons qui ont eu des ratés : le percuteur fonctionne bien ; ce sont donc les cartouches qui étaient mauvaises. Par conséquent, il faudra tester les autres sur du gibier moins dangereux. A peine les mousquetons sont-ils réarmés, KERAVEL voit une bête de taille moyenne qui passe entre deux arbres : il tire et la bête se met à tournoyer sur place, soulevant un petit nuage de poussière. De BEYNAT tire à son tour et la giration s’arrête presque instantanément.
Nous nous approchons et nous nous apercevons que c’est un porc-épic. Dans le terme qui désigne cet animal, il y a porc ; on peut donc présumer que sa chair est comestible. Oui, mais comment rapporter jusqu’au camion cette masse de piquants ensanglantés ? Beynat trouve instantanément la solution : il décroche la bretelle de son fusil et en fixe un bout à une poignée de piquants. Il n’y a plus qu’à traîner le cadavre. De temps en temps nous nous arrêtons pour voir si la chair de l’animal ne touche pas le sol.
Avec ça, on a de quoi manger pendant trois jours… si on le ramène entier, dit BEYNAT .
Nous ne sommes plus qu’à une centaine de mètres du camion et voici que nous entendons un coup de sifflet, puis deux autres coups. Nous nous mettons à courir, toujours en traînant le cadavre, qui dès lors ne glisse plus nécessairement sur les piquants…. Le camion de dépannage est là et les mécaniciens ont déjà commencé à démonter certaines parties du moteur. Une heure plus tard, celui-ci ronfle parfaitement et le petit convoi s’élance sur la piste rocailleuse, emportant le porc-épic, dont la chair a été un peu entamée par la glissade des dernières minutes. Il fera un complément le soir, lorsque toute la Section sera regroupée, du moins nous l’espérons.
Hélas ! une dizaine de kilomètres plus loin, le camion de munitions tombe en panne à nouveau. Les mécaniciens pensent qu’une des pièces du moteur est cassée et qu’il faudra donc en fabriquer une de fortune. Ils ont dans leur camion-atelier ce qu’il faut, mais cette réparation réclamera au moins un jour de travail parce qu’il faut démonter le moteur, puis le remonter, faire des essais, etc. L’ennui, c’est qu’ils n’ont pas suffisamment de vivres et surtout d’eau pour les occupants de notre camion.
Il faudra donc le lendemain chercher de l’eau, et d’autres vivres si possible : la chair du porc-épic ne saurait sustenter une dizaine de personnes pendant deux jours. Dès le lever du soleil, KERAVEL BEYNAT et moi, nous sommes prêts à partir dans la brousse, après avoir bien examiné la carte du chef du camion, sur laquelle figure un tracé de la piste qui part de Keren et aboutit à la route goudronnée Massawa-Asmara.
Nous emmenons KOMALE, un Haoussa (un de ceux qui ont été recrutés à Douala comme ordonnances des officiers) : sa connaissance de la brousse peut être précieuse dans ces recherches d’eau et de vivres ; de plus, en tant qu’Haoussa, il connaît un peu l’arabe. Depuis une demi-heure, nous marchons, un bidon de deux gallons (soit neuf litres environ) à la main, vers le sud-est, sans trop nous écarter de la piste.
Soudain, KOMALE nous fait un signe (que nous ne comprenons pas d’ailleurs) avant de s’enfoncer rapidement au milieu d’arbustes épineux. Nous décidons de nous arrêter et d’attendre. Cinq minutes plus tard, KOMALE surgit, ou plutôt bondit, hors d’un fourré. Que peut-il avoir de si précieux dans la main ? se demande-t-on En guise de réponse, KOMALE nous présente, à notre grand ébahissement, de superbes crottes noires, tout en disant : Moi connais. Ça, beaucoup chèvres.
En effet ce pourrait être des… traces de chèvres, mais aussi d’autres animaux, inconnus et sauvages. Nous consentons cependant à suivre KOMALE , qui nous mène à un endroit où on voit d’abondantes crottes semblables. Pendant une demi-heure, nous suivons donc ces traces et nous arrivons ainsi à une sorte de cuvette, au fond de laquelle se trouve une mare d’eau jaunâtre où barbotent ensemble des gens du pays, des chèvres et quelques ânes. Ces personnes nous ont vus arriver, mais elles ne manifestent ni surprise ni crainte. Avec des gestes et quelques mots d’arabe de KOMALE , d’italien et de mauvais latin d’Yvon et de moi, nous expliquons ensemble, et parfois tout de même à tour de rôle, que nous désirons manger et boire : mandjare, mandjarilla, bere, bibere, agua, aqua, etc.
Les gens du pays ont vite compris ces besoins élémentaires et ils nous montrent d’un geste large cette mare où pataugent des enfants, des femmes, des ânes et des chèvres. Cette eau est répugnante, mais c’est du liquide. Nous débouchons nos bidons et nous les plongeons dans l’eau pour les remplir, puis nous nous mettons à en boire, à en boire…
Dès que notre soif est étanchée nous prenons conscience de notre faim. Reprenant les gestes et certains termes utilisés tout à l’heure, nous essayons de faire comprendre que nous aime rions manger quelque chose. Une femme nous apporte aussitôt une galette jaunâtre, de mais peut-être, et un petit morceau de fromage. Nous mangeons tout cela avec délices, mais il nous semble que notre faim croît à mesure.
Aussi entamons-nous immédiatement des pourparlers pour l’achat de quelques chevreaux. La discussion est laborieuse car les Erythréens ne parlent que de lires alors que nous n’avons que des livres égyptiennes (qui ont cours aussi au Soudan Anglo-Egyptien). Ces livres, en billets de banque, n’ont évidemment aucune valeur à leurs yeux. Soudain, pris d’une inspiration subite, Beynat leur présente quatre pièces d’argent de 10 piastres. Il en faut 10 pour faire une livre égyptienne, mais c’est du métal. Les yeux de nos partenaires s’éclairent immédiatement et le marché est vite conclu : pour ces quatre pièces de 10 piastres, nous pourrons emporter une chèvre et un chevreau ; la première donnera du lait et le second.,, de la viande.
Mais nous ne nous sentons pas la conscience tranquille : 40 piastres pour ces deux bêtes, ça nous paraît une sorte d’abus de confiance.
Evidemment, dit BEYNAT , les billets de banque égyptiens, ça ne semble avoir aucune valeur pour eux. Mais peut-être seront-ils contents de les trouver et de les échanger lorsque la guerre d’Erythrée sera finie.
— C’est vrai, acquiesce KERAVEL . On n’a qu’à leur donner en plus deux billets d’une livre.
Ceci fait, vendeurs et acheteurs se congratulent longuement, puis nous nous en allons, nouveaux pâtres, avec nos bêtes, qui, le cou pris dans une bretelle de fusil, se résignent mal à abandonner leurs compagnons et compagnes.
Au bivouac, on nous fait fête. Le pauvre chevreau est immédiatement immolé par KOMALE et la chèvre est épargnée…provisoirement. Vers quatre heures du soir, le moteur est réparé et les deux véhicules rejoignent sans encombre la route goudronnée qui relie Asmara à Massawa . Dans l’aise des fesses enfin décontractées, nous roulons désormais en direction de Massawa. C’est étrange, dit Yvon KERAVEL j’avais déjà oublié ce que c’est qu’une route goudronnée.
**La mer retrouvée
Les canons sont déjà en position à six kilomètres de Massawa, mais l’assaut n’a pas été donné parce que toute l’Infanterie n’est pas encore en place. Le surlendemain, à l’aube, c’est l’attaque. Cette fois, l’artillerie ennemie riposte, non seulement contre les fantassins, mais aussi contre les artilleurs. Beaucoup de jeunes parmi nous sont tout excités : c’est pour eux le baptême du feu. L’un d’eux va même jusqu’à ramasser des éclats d’obus, à peine refroidis, pour les mettre dans son havresac. Les vétérans rigolent bien. Si tu continues comme ça, lui dit BEYNAT , c’est deux ou trois camions qu’il te faudra !
A midi, les drapeaux blancs commencent à apparaître sur les casemates et les casernements de Massawa. La guerre est finie dans le secteur, et sans faire de victimes chez les artilleurs. Il n’y a plus qu’à attendre que l’ordre nous soit donné d’aller nous installer dans la ville.
Pour l’instant, le plus urgent, c’est de nous nettoyer un peu : nous sommes tous couverts d’un mélange de poussière et de sueur qui colle à notre peau et à nos vêtements. KERAVEL s’aperçoit que son short est tout déchiré. Est-ce par un éclat d’obus ou de pierre, ou encore simplement par une grosse épine ? Il vient d’apprendre que c’est dimanche, et, qui plus est, celui des Rameaux. Ah ! si ma mère me voyait ! dit-il à Alain TARIEC , elle qui tenait tellement à ce que nous soyons habillés de neuf, des pieds à la tête, ce dimanche là ! C’était le jour où on étrennait les vêtements du printemps, quel que fût le temps. Interdiction absolue de porter ce jour-là le manteau ou le pardessus qui avait » fait » l’hiver !
Alain TARIEC sourit sans répondre, non pas qu’il ne pense pas, lui aussi, à sa famille et, tout particulièrement à sa chère grand-mère, mais à cause de l’expression Ah ! si ma mère me voyait ! , utilisée par KERAVEL et qui lui rappelle celle avec laquelle CHAULNES , à Bonabéri, se désolait de s’être encore saoulé.
— Maintenant, me dit-il, c’est la vie de cantonnement qui va reprendre jusqu’à la prochaine campagne. On va donc avoir droit au spectacle des saouleries quotidiennes ! Ah ! si seulement il n’y avait plus ni alcool ni vin à Massawa !
Le lendemain, la Section fait mouvement vers le port. Dans les rues, peu de monde : quelques Erythréens, indifférents, quelques Européens et Européennes qui passent vite, les yeux baissés ou détournés. Parfois un civil italien lève un peu le bras en signe d’amitié : ce doit être un antifasciste, donc un ami de la liberté. Mais cela aussi, c’est difficile à supporter pour nous ’ parce que ce geste nous rappelle qu’à l’entrée des Allemands à Paris, il s’est trouvé des collaborateurs pour applaudir.
La Section d’Artillerie est cantonnée, au bord de la mer, dans des baraquements d’une caserne, très confortable d’ailleurs puisque, au plafond de chaque chambrée, tournent plusieurs grands ventilateurs. Ces baraquements sont sur pilotis, ce qui nous paraît étrange et le restera… tant que la saison des pluies n’aura pas commencé.
A Massawa le vin est pratiquement introuvable mais il reste, hélas ! de bons stocks d’anisette. Du coup, la Section a droit chaque soir à la chanson On s’était connus dans un guinche… et à quelques divagations de buveurs qui, heureusement, s’endorment en général assez vite. L’un d’eux toutefois commence par piquer des colères inquiétantes. Une fois il s’est même armé de sa baïonnette et il menace on ne sait trop qui. Par chance, deux copains, qui ne sont pas encore dans la chambrée, arrivent par derrière, le ceinturent et l’obligent à lâcher son arme. provisoirement.
Vers quatre heures du soir, le moteur est réparé et les deux véhicules rejoignent sans encombre la route goudronnée qui relie Asmara à Massawa. Dans l’aise des fesses enfin décontractées, nous roulons désormais en direction de Massawa. C’est étrange, dit Yvon KERAVEL , j’avais déjà oublié ce que c’est qu’une route goudronnée.
Le lendemain, la Section fait mouvement vers le port. Dans les rues, peu de monde : quelques Erythréens, indifférents, quelques Européens et Européennes qui passent vite, les yeux baissés ou détournés. Parfois un civil italien lève un peu le bras en signe d’amitié : ce doit être un antifasciste, donc un ami de la liberté. Mais cela aussi, c’est difficile à supporter pour nous parce que ce geste nous rappelle qu’à l’entrée des Allemands à Paris, il s’est trouvé des collaborateurs pour applaudir.
La Section d’Artillerie est cantonnée, au bord de la mer, dans des baraquements d’une caserne, très confortable d’ailleurs puisque, au plafond de chaque chambrée, tournent plusieurs grands ventilateurs. Ces baraquements sont sur pilotis, ce qui nous paraît étrange et le restera… tant que la saison des pluies n’aura pas commencé.
Un soir DARNETAL , après avoir tourné longtemps autour d’Yvon, lui glisse à l’oreille : Dis donc, Keravel, t’es bête de distribuer à tout le monde tes sèches. Tu devrais me les réserver toutes. Je te paierais, moi, et même le double de ce que ça coûte à la N.A.A.F.I.
— Qu’est-ce que tu dis ? se récrie Yvon. Tu me prends donc pour un salaud ?
Atterré par cette riposte, tellement inattendue, DARNETAL bredouille :
— A la Légion, il y en a bien qui ont vendu de l’eau à leurs copains, à une livre le quart, et même à cinq livres le bidon d’un litre, pendant l’attaque de Keren.
— Je sais, riposte Keravel, qu’il peut se trouver quelques salauds dans n’importe quel groupe. Mais ce n’est pas une raison pour les imiter.
Devant l’air effaré de Darnétal, Yvon KERAVEL ne peut pas s’empêcher de rire et il ajoute aussitôt :
— Mais rassure-toi : je continuerai à te donner ma ration de cigarettes quand ce sera ton tour.
— T’es quand même un brave type, lui dit Darnétal en lui tapant sur l’épaule.
A peine son copain est-il parti, Yvon s’aperçoit que j’ai assisté à la scène et il me dit :
— Au fond, j’aurais dû lui promettre un tour de faveur à la prochaine distribution de cigarettes : peut-être qu’il boirait moins s’il avait sa ration habituelle.
Plusieurs baraquements militaires sont inoccupés et les copains, victorieux , errent dans les diverses salles, cherchant des choses à récupérer . Cet euphémisme recouvre en fait toutes sortes d’activités, qui vont de l’utilisation légitime des objets laissés par l’armée ennemie jusqu’au pur pillage.
Certains copains sont de véritables spécialistes de cette récupération . C’est le cas en particulier d’un gars du Nord de la France, COUDEKERQUE , qui habite, paraît-il, près de la frontière de la Belgique et qui prétend avoir surtout vécu de contrebande. Il affirme même avoir passé plusieurs fois la frontière en voiture blindée. Comme il est hâbleur par nature, personne n’a cru à son histoire, mais il est certain qu’il a beaucoup de dispositions pour la récupération : dès le premier jour il a rapporté, entre autres objets, un violon, trouvé dans un des baraquements désertés. Ayant eu l’imprudence de dire que je savais jouer de cet instrument, j’en suis devenu le dépositaire, ce qui m’a valu l’obligation de grincer pendant des heures toutes les chansons (de Tino Rossi, de Rina Ketty, de Charles Trenet, de Maurice Chevalier, etc.) à la mode avant la guerre. Un des copains m’a même demandé si on pouvait jouer sur cet instrument les sonneries militaires… et j’ai dû sonner :
— C’est pas d’la soupe, C’est du rata…
et
— L’adjudant rentre au quartier, Les moustaches emm…
Pendant ce temps, COUDEKERQUE continue à récupérer sans se demander comment il va pouvoir emporter tout le matériel qu’il rapporte quotidiennement. Dans le lot, certains objets sont susceptibles d’une utilisation immédiate : il s’agit de grenades à main, dont il a déjà une centaine. Il vient d’inventer un nouveau sport : la pêche à la grenade. Pendant deux jours, il lance de ces engins, dégoupillés, dans la mer. Après chaque explosion, une dizaine de poissons flottent sur l’eau. Le cuistot et ses rationnaires sont ravis de cet extra , qui change de l’ordinaire, c’est-à-dire de l’inévitable corned-beef, mais une seule explosion suffirait largement à alimenter toute la Section. Coudekerque ne saurait s’en contenter et il continue à faire exploser ses grenades dans la mer… jusqu’à ce que l’ordre arrive (enfin !) de faire cesser ces explosions.
Les grands bénéficiaires de ces pêches miraculeuses ont été les chats qui ont établi leur quartier dans ces baraquements. La nuit, nous sommes constamment réveillés par les cris de ces bêtes, du moins au début de notre séjour. Progressivement ceux-ci diminuent. Ils finissent par cesser complètement. Au bout d’une semaine, je m’en étonne devant le cuistot et celui-ci éclate de rire :
— Ah ! me dit-il, t’en as de bonnes, toi ! T’en as mangé pendant plus de dix jours et tu t’étonnes qu’il n’y en ait plus !
C’est alors seulement que je m’aperçois qu’on ne se préoccupe guère de l’origine des aliments que la Section offre à ses pensionnaires : cette viande qui nage dans la sauce aurait très bien pu être du singe italien, cette viande en boîte qui ressemble beaucoup à son frère français et qui se prête, nettement mieux que le corned-beef, aux accommodements culinaires.
— Tu ne trouves pas, reprend le cuistot, que ça a une saveur spéciale, le chat nourri uniquement de poisson ?
Plusieurs parmi nous se sont mis à apprendre l’italien avec l’aide de Bernard CASTELLET, qui avait déjà quelques notions de cette langue grâce aux nombreux camarades d’origine italienne avec qui il jouait jadis lorsqu’il passait ses vacances à Montferrat, petit village du Var où habitent ses grands-parents. Ces notions, plus qu’élémentaires et surtout mal coordonnées entre elles, ne lui auraient jamais permis de lire les livres italiens récupérés , mais, dans le lot, il se trouvait quelques missels latin-italien . Bernard a un peu oublié son latin et surtout, il n’a jamais pratiqué celui des offices religieux, mais Yvon KERAVEL et moi, qui avons passé sept ans dans un Collège catholique et avons donc assisté à la messe tous les jours pendant toute cette scolarité, nous connaissons parfaitement cette langue particulière et nous pouvons donc traduire ces offices en français. Progressivement, nous nous perfectionnons donc en italien grâce à la mise en commun de ces diverses ressources, sous la férule de CASTELLET, qui a consenti à quitter pour quelques heures les Pensées de Pascal et les Essais de Montaigne.
Notre groupe d’étudiants (si l’on peut dire) est bientôt rejoint par GRADENHEIM, un téléphoniste comme BEYNAT, un gars très timide et souvent triste (surtout, semble-t-il, parce qu’il s’inquiète du sort de sa famille, qui est juive et n’a pas pu probablement passer en France non-occupée ). Il était élève dans une école d’ingénieurs-électriciens à Paris.
Mobilisé au début de 1940 et blessé à Dunkerque, comme BEYNAT et CASTELLET il a été transporté en Angleterre et il n’a eu aucune nouvelle de sa famille depuis dix mois. Il s’est passionné pour l’étude de l’anglais, qu’un moins d’un an il a appris à parler correctement, et maintenant il voudrait apprendre l’italien. Comme GALAMIAN, il ne connaît pas le latin et a donc du mal à deviner le sens de certains mots. Qu’importe ? Il se constitue, comme GALAMIAN lui-même, une liste de mots et, chaque jour, tous deux se mettent à l’écart des autres pendant une heure pour apprendre et réviser leur vocabulaire italien . Il y a bien quelques civils italiens, donc libres encore, dans Massawa, mais une certaine pudeur, due à notre situation de soldats en occupation , nous empêche d’avoir des rapports avec nos frères latins malgré la sympathie que nous éprouvons spontanément pour eux et pour leur culture.
La saison des pluies a commencé et nous nous apercevons bien vite de l’utilité des pilotis qui nous ont tellement étonnés à notre arrivée dans ce cantonnement. Dans les cours, il y a en permanence une cinquantaine de centimètres d’eau. Comme nous n’avons pas de bottes, nous ne sortons que nu-pieds, ce qui a pour effet de limiter l’approvisionnement en anisette et donc les saouleries vespérales.
Pendant un mois, nous nous demandons où on va nous envoyer maintenant.
Sera-ce en Libye ? Ou en Somalie ? Ou bien en Egypte tout simplement ? L’ordre arrive enfin de se préparer à partir deux jours plus tard, mais la destination reste toujours inconnue. En attendant, chacun s’évertue à essayer de loger dans l’un ou l’autre des camions le matériel qu’il a récupéré .
J’ai d’ores et déjà l’assurance de plusieurs copains qu’ils se débrouilleront pour planquer le violon dans leur camion. Même COUDEKERQUE , qui est chauffeur, est prêt à sacrifier une partie de son stock de grenades pour héberger cet instrument précieux, qui en somme appartient à toute la Section désormais.
Q ui sait, je me demande, combien de temps on pourra le conserver ?


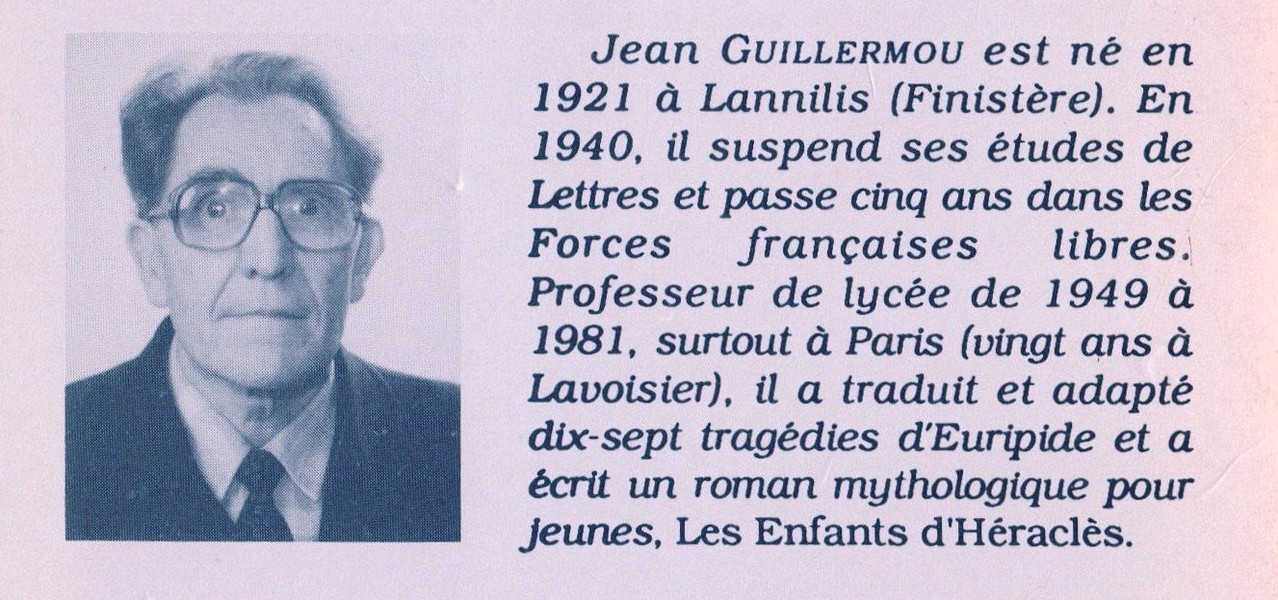
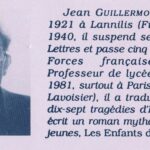


Laisser un commentaire