*Chapitre 10 de l’ouvrage de Daniel RONDEAU et Roger STEPHANE : des Hommes Libres 1940-1945.
La France libre par ceux qui l’ont faite. Ed. Grasset, 1998
**CHARLES DE GAULLE
Mais la plus grande affaire était, maintenant, d’amener en mer Rouge, depuis l’Afrique équatoriale, une division, – hélas ! légère, – et d’obtenir qu’elle participât, comme telle, aux opérations.
Or, c’était en Erythrée et en Ethiopie que le Commandement britannique voulait porter l’effort, au printemps, de manière à liquider l’armée du Duc d’Aoste avant d’entamer autre chose sur les rives de la Méditerranée. Quelles que fussent les distances, j’entendais qu’un premier échelon français prît part à l’action ».
Dès le mois de juillet 1940, celui qui allait devenir l’amiral Patou, Roger Barberot, d’Estienne d’Orves quittent, nous l’avons vu, la force X d’Alexandrie pour rejoindre la France Libre. Au mois de décembre 1940, l’enseigne de vaisseau IEHLE prend la même décision, non sans avoir longuement réfléchi. Il a d’abord demandé à être reçu par l’amiral Godfroy, commandant de la force X.
**Pierre IEHLE
II m’a fixé un rendez-vous et je me suis présenté seul lui dans son salon. Il faut bien se rendre compte de la scène : se présenter, à cette époque, devant un amiral qui avait trois étoiles, de la part d’un jeune enseigne à deux galons simplement pour essayer de lui dire : Je ne suis pas d’accord avec ce que vous nous avez dit en public ni ce que vous voulez nous faire faire . c’était quand même un peu osé, et je tremblais intérieurement. J’ai été extrêmement déçu parce que Godfroy ne m’a pas laissé ouvrir la bouche, c’est-à-dire que je n’ai pas pu expliquer ce qui me troublait, quelles étaient mes pensées et mes idées personnelles à ce moment-là. Il m’a fait un très grand discours qui a duré plus de trois quarts d’heure et qu’il a terminé par quelque chose qui m’avait beaucoup remué : Et puis, après tout, qu’est-ce que vous auriez à faire du côté de l’Angleterre, vous ne vous rendez donc pas compte que la guerre est perdue pour ce pays-là et qu’il n’y a rien à faire contre la force allemande telle qu’elle est .
J’ai quand même réussi, à ce moment-là, à lui glisser un mot, mais un seul, et à dire : Et la Russie ? Et il m’a regardé en haussant les épaules avec, sur son visage l’expression manifeste de quelqu’un qui regarde avec dédain un jeune homme qui ne connaît rien aux problèmes diplomatiques ni aux affaires étrangères de la Russie : elle a un accord avec l’Allemagne, jamais de la vie elle n’entrera à aucun moment, en lutte avec l’Allemagne, c’est fini, il faut l’admettre et se préparer à attendre pendant des années des temps meilleurs. Je suis parti de là n’ayant, d’une part, pas pu exposer mes problèmes, et, d’un autre côté, profondément écœuré par la réponse de l’amiral Godfroy.
C’est à ce moment-là, et dans ces conditions, que j’ai décidé de partir, et de quitter la Marine. En décembre, je suis entré en contact au Caire avec le représentant de la France Libre qui n’était autre que le général Catroux. J’ai été tout de suite extrêmement impressionné, d’abord par sa stature, et ensuite par sa façon de recevoir les gens, totalement à l’inverse de l’amiral Godfroy. Il me dit : Que pensez-vous ? Que voulez-vous faire ? Quelles sont vos idées ? Et il me laisse parler, de sorte que, mis en confiance par son attitude, pendant près de vingt minutes ou une demi-heure je lui dis très simplement ce que j’ai sur le cœur, ce que je voudrais pouvoir faire, ce que je souhaiterais pouvoir faire, ce que j’étais, ce que je connaissais, ce pourquoi on m’avait élevé, instruit et éduqué, il me laisse partir en me disant : Je ne vous fais aucune promesse, je peux pas vous dire que vous irez certainement dans l’armée de terre, mais pou : moment vous partez après-demain pour Fort-Lamy au milieu du Tchad.
Dès mon arrivée à Fort-Lamy, j’apprends que le bataillon du Tchad auquel je suis affecté doit partir pour l’Erythrée . J’ai rattrapé mon bataillon dans le Soudan anglo-égyptien et en me présentant à GARBAY , j’ai manifestement vu qu’il se disait : Qui peuvent bien être ces fous au Caire pour m’envoyer un officier de marine ? Il a quand même été gentil et il m’a dit : Écoutez, je vais vous donner une section. . Il m’a donné une section de mitrailleuses à commander. J’étais extrêmement : fier. Le bataillon a continué sa marche, on est arrivés un peu en dessous de KHARTOUM où on a passé une quinzaine de jours, puis on a pris le train et on est allés s’embarquer dans un petit port, très joli, au bord de la mer Rouge. Là, on a pris un bateau et pour une fois GARBAY s’est dit Après tout, mon marin peut peut-être me servir. Et il m’a chargé d’être l’officier d’embarquement et de débarquement.
Ce n’était pas une petite chose, avec ces Noirs qui n’avaient jamais vu la mer puisqu’ils venaient du centre de l’Afrique, qui étaient fort étonnés de tout ce qu’ils voyaient, ils ne savaient pas non plus ce que c’était qu’un bateau, surtout un bateau aussi gros. On a débarqué le long du rivage, dans un petit coin de l ’Erythrée italienne du Nord. Là, les bateaux s’échouaient avant d’arriver à terre et, évidemment, on a eu un mal inouï à transférer les tirailleurs sénégalais de ces barques qui s’échouaient avant d’arriver au rivage, en les obligeant à entrer dans l’eau et à transporter les caisses de munitions et tout ce qui s’ensuit, les armes, les mitrailleuses sur leur tête.
Pourquoi l’Erythrée ? On a compris que toute la bataille qui se déroulait sur la rive méridionale de la Méditerranée avait pour enjeu le canal de Suez. Mais pour que cette voie maritime, alors vitale pour l’Empire britannique, fût utilisée, encore fallait-il que les rives de la mer Rouge fussent nettoyées de toute présence ennemie. Les Italiens occupaient l’Erythrée, leur colonie depuis 1890. Selon le propos du général de Gaulle aux termes duquel la France Libre doit être partout au contact de l’ennemi, des éléments français sont engagés en Erythrée aux côtés de nos alliés britanniques.
**BERNARD SAINT-HILLIER
Je dois dire qu’en plus du bataillon de marche n 3 du Tchad , il y avait un e scadron de spahis marocains, l’escadron JOURDIER, engagé en Erythrée indépendamment de nous, mais qui a fait des choses absolument remarquables, notamment une charge de cavalerie au sabre.
Il y avait également la Brigade française d’Orient , qui venait de Douala. Elle était constituée essentiellement par un bataillon de Légion étrangère , par des éléments de commandement de ce bataillon et de la brigade, soit au total mille cinq cents Français environ. Nous avons été une force d’appoint pas considérable, mais tout de même sérieuse. Nous représentions à peu près le cinquième de tous les éléments alliés.
**PIERRE IEHLE
Le 20 février 1941, à KUB-KUB, nous sommes absolument seuls. Nous remplaçons des Anglais qui viennent de se faire étriller par les Italiens. Il s’agit de forcer un défilé tenu solidement par l’armée italienne, nettement supérieure. Il y a une petite rivière encaissée et puis des montagnes tout autour et les Italiens tiennent la rivière ainsi que les montagnes qui dominent le défilé, très solidement. Il n’y a rien à faire pour attaquer de front. Autre problème qui va commander tout le cours de la bataille : il n’y a pas d’eau, car cette rivière court en dessous de la terre, ou plutôt du sable, elle ne refait surface qu’à certains endroits très rares et qui sont précisément tenus par les Italiens.
Nous ne pouvions pas rester là plus de quelques jours faute d’eau et il fallait, ou bien battre les Italiens ou bien reculer et s’en aller, c’est-à-dire avouer un second échec après celui qu’avaient encaissé les Britanniques. On a attaqué d’abord avec trois compagnies mais uniquement pour tromper les Italiens. On a fait revenir immédiatement deux de ces compagnies et, après une heure d’arrêt, dans la nuit, nous sommes repartis à travers la montagne par une escalade extraordinaire pour contourner complètement les Italiens et venir les attaquer par-derrière. Ça a été une surprise totale et ils ont retourné toutes leurs armes contre nous, canons, mortiers, les tirailleurs n’avaient jamais vu ça, bien sûr, c’était la première fois qu’ils se battaient, pour moi aussi, c’était le baptême du feu et j’étais assez impressionné. Finalement nous voilà repoussés, et très dispersés !
La situation se présentait extrêmement mal. Je me suis trouvé avec un groupe d’une cinquantaine de tirailleurs. J’ai dit : Fonçons, allons-y , on a continué de l’avant et on est tombés sur l’arrière des Italiens, sur un point d’eau. L’autre partie des Sénégalais a voulu repartir par-derrière, c’est-à-dire refaire le trajet dans la montagne, et ils ont subi les affres de la soif, au point de tuer des chameaux pour leur ouvrir la vessie et boire cette espèce d’eau liquide verte qui se trouve à l’intérieur de leur panse. Nous nous sommes installés sur un petit piton en bordure de l’eau, quelques officiers, d’autres hommes nous ont rejoints, finalement on s’est trouvés près de cent cinquante avec deux capitaines.
Nous tenions le point d’eau, mais sans nous en être rendu compte tout de suite. Les Italiens nous bombardaient d’appuis plus élevés. La nuit, nous descendions prendre l’eau en profitant de l’obscurité. Les Italiens n’ont jamais pu avoir d’eau. Au bout de trois jours d’échanges meurtriers, le chef de bataillon resté seul là-bas a vu avec stupéfaction les Italiens s’en aller et nous avons crié : Victoire ! On a eu quand même pas mal de morts et de blessés, et nos munitions étaient totalement épuisées.
C’est là où j’ai vu mes premiers prisonniers, et parmi ces prisonniers italiens il y avait un lieutenant de mon âge et je me sentais une grande affinité avec lui. Il parlait un français admirable, nous l’avons invité à venir s’asseoir autour de notre feu de camp et à partager notre repas. Et il nous a expliqué, avec beaucoup d’ardeur, de vivacité, pourquoi il était fasciste, ce qu’il voulait faire de son pays, pourquoi il se battait, pourquoi il était militaire, et il a terminé en ajoutant qu’à la même minute, la veille, les forces alliées subissaient, affirmait-il, une pilule monumentale sur la côte de Libye et à la frontière libo-égyptienne. C’était l’arrivée des Messerschmitt du côté de Tobrouk.
Il est reparti le lendemain, comme prisonnier, vers l’arrière, mais il m’avait beaucoup impressionné parce que je me suis dit : bien, voilà quand même quelqu’un de convaincu. Il y en a des deux côtés, certainement il croit à ce qu’il dit, et puis, voilà, il est fait prisonnier dès le début maintenant il ne sera plus rien, et va terminer sa vie derrière des fils de fer barbelés.
C’est le moment où, à cause des pertes, GARBAY me nomme capitaine de compagnie. C’est difficile à comprendre maintenant, mais c’est un bataillon qui comprenait quatre compagnies, il y avait donc quatre capitaines de compagnie. J’avais à commander deux cent cinquante tirailleurs, un certain nombre de sous-officiers français et j’avais sous mes ordres deux officiers de l’armée de terre dont l’un, officier d’active, était entré à Saint-Cyr la même année que moi à Navale. Logiquement c’est lui qui aurait dû prendre le commandement, et on me l’a donné à moi. Je me suis senti devenir quelqu’un d’extraordinaire, après avoir été admis dans ce bataillon un peu comme un étranger et en tout cas comme un marin qui venait dans un endroit où il n’aurait jamais dû mettre les pieds.
C’est là, avant de partir pour KEREN qu’un jour GARBAY me fait appeler et me dit : Demain vous recevez trente-deux chameaux et dix-sept mulets. Nous partons dans la montagne .
A KEREN ce sont de montagnes, très élevées, jusqu’à deux mille cinq cents mètres, et comme il n’y a pas de routes, il n’y a pas de sentiers, on court dans la montagne comme on peut, et pour transporter notre matériel il avait trouvé quelqu’un, c’était moi, avec mes trente-deux chameaux et dix-sept mulets. J’avais la compagnie lourde, c’est-à-dire les mitrailleuses, les mortiers et toutes leurs munitions. Je n’ai trouvé qu’un sous-officier français et un tirailleur sénégalais qui savaient vaguement ce que c’était que des chameaux. Les Arabes qui nous amenaient les chameaux sont partis aussitôt, ne voulant pas se mêler de ces combats, et on a essayé le lendemain de voir comment on allait monter tout ce matériel sur leur dos. C’est là que j’ai appris quel était le poids de chaque charge, qu’il fallait absolument balancer ces charges, faire asseoir le chameau, le faire baraquer et puis fixer la charge en la soulevant simultanément de chaque côté par deux hommes pendant que le chameau, naturellement, crie à perdre haleine parce qu’il proteste toujours, il n’est jamais d’accord. Il fallait aussi peser les caisses de munitions, voir de quel côté les mettre pour arriver à quelque chose d’équivalent à droite et à gauche ainsi qu’un poids correspondant à la charge maximum, fixer les mortiers et les mitrailleuses sans avoir de cordes, tout cela sur une montagne pelée où il ne poussait pas un arbre. On a fauché les fils téléphoniques italiens qui traînaient un petit peu partout par terre. On a réussi à se débrouiller et le surlendemain, après beaucoup de mal, on s’est mis en route à six heures du matin pour trois étapes de marche à pied en direction de la bataille de Keren.
**BERNARD SAINT-HILLIER
C’était une progression vraiment très pénible. La végétation était très rare : il y avait des cactus, des baobabs, ce genre d’arbres complètement idiots, qui n’ont pas d’ombre, qui sont creux, qui sont énormes. Et nous faisions une série de points de ravitaillement dans lesquels on accumulait des vivres, de l’eau, et des munitions, pour nous permettre ensuite de descendre sur KEREN et de couper les arrières italiens derrière KEREN. Après une journée harassante, nous montions une pente assez usante et nous étions engagés dans une sorte de cratère d’érosion quand nous avons été surpris par les Italiens qui nous ont envoyé quelques obus de mortier. Il a fallu se dégager. On a envoyé la Légion, flanquée par deux compagnies du bataillon de marche n°3. Les hommes ont attaqué. Après une attaque assez rude et les chaleurs étouffantes de l’oued, après aussi une escalade mouvementée de plus de trois cents mètres, ils se sont retrouvés sur un sommet où l’air était très froid.
**PIERRE IEHLE
Arrivés au sommet d’une montagne, on nous a dit : En face, c’est les Italiens. Alors, on a aménagé des petites murettes, on s’est installés dans des trous, et ça n’a pas tardé. On a tout de suite commencé à tirer, à échanger des coups de toute espèce mais principalement de mortier car, lorsqu’on occupe deux pitons qui sont séparés par une grande vallée, le mortier est de loin l’arme la meilleure, bien supérieur à la mitrailleuse pour se tirer dessus. On tirait aussi, de temps à autre, à la mitrailleuse. Ça a duré assez longtemps. On est restés là, on faisait des patrouilles de nuit entre les lignes, on s’arrosait réciproquement, on se démolissait les abris.
**BERNARD SAINT-HILLIER
Alors nous avons vu une position qui nous dominait : L’ ENGHIAHAT , qui était très, très rude, très dure, et était séparée de nous par un ravin. Et l’ordre nous a été donné de l’attaquer. Et je pense que ce doit être le 17 mars. Nous avons monté une attaque qui aurait dû être une attaque surprise, à l’aide de deux compagnies, la 2e compagnie qui était la compagnie MOREL , et la 3e compagnie qui était la compagnie LAMAZE. Leur mission était de descendre nuitamment au fond du ravin et de remonter de l’autre côté, à pic, ce qui représentait à peu près douze eu quatorze cents mètres de dénivelée.
C’était très pénible et nous n’avions pas de ravitaillement. Il n’y a notamment pas beaucoup d’eau et la compagnie MOREL par exemple s’est enfoncée dans la nuit alors qu’elle avait à peine un litre, un litre et demi d’eau par individu, ce qui est nettement insuffisant pour une journée de combat.
L’affaire aurait peut-être pu réussir mais l’avance de la compagnie MOREL a été signalée aux défenseurs italiens par une bande de singes qui a poussé des cris. Les singes ont joué les oies du Capitole.
Au soir du 17 mars, il a fallu récupérer, retrouver tous nos blessés, les ramener. Ce fut impossible, hélas, pour ceux qui se trouvaient immédiatement sous le feu des Italiens, des ascaris italiens. Et les oscars c’étaient des francs gaillards, ils avaient d’ailleurs une méthode curieuse parce qu’ils portaient des grands paniers, énormes, où le grenadier puisait à deux mains. Avec le dénivelé qu’il y avait, ça faisait des portées terribles, ils lançaient au commandement, c’étaient de véritables rafales de grenades qui partaient. Finalement, nous sommes redescendus vers le torrent, un petit peu au nord, de façon à pouvoir nous refaire reprendre notre affaire.
Nous avons réattaqué L’ ENGHIAHAT , avec un appui tout de même un petit peu plus sérieux. D’abord quelques avions qui ont lancé des bombes et des grenades. Il y avait aussi des canons, une section de 75 de montagne récupérés sur les Italiens à KUB-KUB, et nous avions naturellement-comme la première fois, les mortiers et les mitrailleuses des compagnies IEHLE et AMILAKVARI , et même le renfort d’une compagnie du bataillon d’infanterie de marine que commandait le capitaine SAVEY , un prêtre dominicain. L’attaque aurait été parfaite si l’ennemi était resté. Mais malheureusement il n’avait laissé que des éléments retardateurs, et avait profité de la nuit pour s’éclipser.
**PIERRE IEHLE
Le général LEGENTILHOMME nous a dit : II faut faire la poursuite des Italiens maintenant, dégringoler dans la vallée et cour et marcher à toute vitesse. Je n’ai que vingt-cinq chameaux , parce qu’on en avait pas mal qui étaient morts et qui étaient tombés dans les précipices… Je n’ai que vingt-cinq chameaux. Qui est-ce qui va partir ? Naturellement, SIMON et moi, on voulait tous les deux partir, et j’ai sorti ma botte secrète qui m’a donné la préférence. J’ai dit à Simon : Comment est-ce que tu vas fixer tes charges sur les chameaux ? II m’a dit : Je prendrai les ceintures de mes légionnaires. Et moi j’ai répondu : Et moi j’ai des cordes , parce que je les avais mises de côté. Et c’est la Compagnie d’accompagnement, des tirailleurs sénégalais qui a été désignée. On a fait venir les chameaux, on a tout monté dessus. La nuit était venue et on a commencé à descendre des précipices par des sentiers de chèvre. Les chameaux disparaissaient parfois dans les précipices sans qu’il soit question d’aller les chercher. Tout chameau qui dégringolait était perdu. On a marché sans arrêt pendant près d’une quarantaine de kilomètres dans des conditions effroyables jusqu’au soir de la journée suivante où, à bout de forces et n’ayant pas rattrapé les Italiens, il a fallu s’arrêter pour que les hommes puissent quand même commencer à manger et à boire.
**BERNARD SAINT-HILLIER
Bref, nous avons poussé tant que nous pouvions et nous sommes arrivés à ABBI MANTEL. Et c’est là que nous avons récolté les derniers survivants de la division des grenadiers de Savoie qui se retiraient en très bon ordre. Je crois qu’ils étaient de l’ordre de deux cents ou trois cents Blancs. Et nous avons fait, entre le BM3 et nous-mêmes, près de mille prisonniers.
Et nous étions là, à Abbi Mantel, quand nous avons vu arriver le général commandant en chef venu nous féliciter parce qu’il ne s’attendait vraiment pas à nous voir là, nous avions vraiment coupé la route sur ASMARA . Puis, nous sommes remontés très haut vers nos points de départ pour retrouver nos impédiments, et c’est là d’ailleurs où nous avons eu la bonne surprise d’être inspectés par le général de Gaulle, que je n’avais jamais vu.
**PIERRE IEHLE
J’avais ma compagnie à présenter au général de Gaulle, ce qui représentait quand même quelque chose d’assez important. Je me rappelle que j’avais organisé mon affaire de manière à ce que mes différents tirailleurs sénégalais soient alignés sur un talus qui surplombait un petit peu le sentier sur lequel devait passer le Général, et, au premier rang, j’avais naturellement mis les plus grands des tirailleurs sénégalais, c’est-à-dire que, pour une fois, le général de Gaulle a passé une inspection en regardant vers le haut au lieu de regarder vers le bas. Il n’a pas fait d’observation d’ailleurs, mais nous avons tous, évidemment, été extrêmement impressionnés par son passage.
Ensuite on nous a fait faire un tour fantastique à pied pour rejoindre la mer à travers cette région composée de dunes de sable qui s’étendent à l’infini. Nous avions des camions français, c’était la fameuse compagnie de transport venue d’Angleterre, avec les légionnaires, et on les acheminait à toute vitesse dans le sable pour essayer de gagner de vitesse les Anglais qui descendaient, eux, par la route normale, et on est arrivés les premiers à MASSAOUAH , en pleine nuit, le 7 avril 1941 .
**ROGER BARBEROT
II y avait toute l’équipe de la Légion, Bollardière. Messmer, et Simon bien entendu, qui se préparaient au couronnement final.
**PIERRE IEHLE
On se précipite, naturellement, et je me rappelle que nous, nous sommes arrivés devant l’Amirauté italienne où se trouvaient alignés, nous attendant, tous les officiers de marine italiens en grand uniforme. On était sales, on était en short kaki, on n’était pas en situation, évidemment, pour représenter dignement ni l’armée ni la marine française en face de tels gentilshommes. On les a faits prisonniers, bien sûr on les a enfermés quelque part, je ne sais plus où, et puis on a attendu les autres, après avoir pris casernement dans Massaouah . Ça a duré de dix à quinze jours et on s’est largement ré-équipés sur les stocks italiens. Alors là, si avant on n’avait plus une seule chemise de rechange, on en avait maintenant toute une collection. Je n’ai pas hésité une minute à me servir de tout ce que j’avais estimé nécessaire, après cette première expérience parmi les stocks italiens. Je n’ai pas été le seul, tout le monde a fait la même chose, de sorte que lorsque nous avons embarqué sur un bateau à Massaouah , un bateau hindou, pour remonter la mer Rouge, le bataillon était infiniment plus lourd qu’il l’était lorsqu’il avait quitté Fort-Lamy peu près deux mois auparavant.





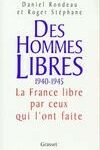






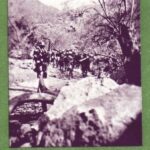





Laisser un commentaire