*AVRIL – AOUT 1944 : ITALIE
II régnait une grande activité dans le port de Naples . Nos chars mis à terre, nous avons mis le cap sur Albanova, un village situé à une vingtaine de kilomètres au nord de Naples et à une trentaine de kilomètres au sud du front. Je connaissais un peu l’Italie à travers les livres, pour avoir étudié l’histoire romaine au collège. La région que je découvrais me paraissait bien pauvre et les gens assez misérables. Cependant, en général, nous n’éprouvions que peu de sympathie à leur égard. Nous n’arrivions pas, en effet, à oublier que l’Italie nous avait lâchement déclaré la guerre en juin 1940 alors que nous étions en bien fâcheuse situation.
C’est à Albanova que j’ai fait la connaissance de Germaine SABLON , une chanteuse de grand renom, volontaire à l’ambulance chirurgicale de la division. J’étais dans une espèce de bistrot-cantine avec quelques camarades lorsque l’un d’eux me dit : Tiens là-bas Germaine Sablon attablée avec des militaires , et il me met au défi d’aller la saluer. Il ne m’en faut pas plus pour que je me présente à elle que je ne n’avais jamais vue ni entendue. J’apprends que vous êtes Germaine SABLON , lui dis-je, et je viens vous saluer.
Le sourire et un mot aimable de la chanteuse m’incitent à poursuivre.
— Eh bien voilà ! Je suis chauffeur (les puristes disent pilote) de char. Nous allons être engagés bientôt et je viens faire votre connaissance pour le cas où je devrais faire appel aux compétences de l’ambulance chirurgicale . Mais, mon petit, faut pas y penser.
J’y pensais tout de même un peu au danger que nous allions affronter et pourtant.je n’ai jamais trop eu le pressentiment du risque. Après ce court entretien, j’ai rejoint mes camarades, contrat rempli. Dans les premiers jours de mai nous nous approchons du front et dans la nuit du 10 au 11 mai nous bivouaquons à proximité des lignes dans un champ, nos chars camouflés autant que possible le long des haies. Les dix-sept équipages de chars du 1e escadron, soit soixante-huit hommes, sont réunis dès le matin pour s’entendre dire :
— Interdiction de nous montrer, donc de sortir du champ. Demain matin, nous formons l’élément de pointe d’une attaque de la ligne Gustav de l’autre côté du Garigliano. Débarquement demain en Europe de l’Ouest et attaque massive sur le front russe.
Je dois avouer que je n’ai pas tellement apprécié la journée de repos qui nous était octroyée, pourtant le soleil était bon et chaud, le ciel d’azur, l’herbe d’un beau vert…, mais il y avait demain !
Vers 22h, nous descendons par un chemin de terre vers le Garigliano. C’est alors que notre artillerie entre en action. L’éclat des départs et l’explosion des arrivées sur les collines en face illuminent le paysage. Ce spectacle est hallucinant, mais je n’ai guère le loisir de l’apprécier car il m’appartient de suivre le char qui me précède. Protégés par les fumigènes, nous avons passé la rivière sur un pont de bateaux mis en place par le génie et après quelques centaines de mètres, toujours dans l’obscurité, nous avons fait halte. Nous sommes sortis de nos engins pour nous dégourdir les jambes jusqu’au moment où des obus de mortiers nous rappellent à la réalité et nous incitent à réintégrer nos places à l’abri du maigre blindage (3 centimètres si mes souvenirs sont exacts) de nos chars.
Le jour commence à poindre lorsque nous nous remettons en route. Gravissant une butte, je vois le char qui me précède disparaître bien rapidement. Je comprends le phénomène lorsque mon char bascule au sommet de l’obstacle et que je me retrouve, comme mon collègue, dans un trou, sans doute le fossé antichar. Heureusement que les camarades qui nous suivaient ont été plus malins que nous ; ils se sont arrêtés à temps et nous ont aidés à sortir du piège. Pourtant je m’y trouvais bien,à l’abri !
Nous avons continué notre progression dans une sorte de prairie marécageuse. Au bout d’un moment, je sens mon char qui patine et bientôt, je ne peux plus manœuvrer, ce qui est également le cas de ceux qui avançaient avec nous. Aucun ordre ne nous parvient. C’est la pagaille ! Apparemment nous devons être dans les lignes ennemies. Des balles sifflent autour de nous. Mon char a pris quelque liberté avec l’horizontale, aussi il nous est impossible d’utiliser le canon et deux des trois mitrailleuses. Seule la mitrailleuse de D.C.A. peut être enlevée de son affût et utilisée à terre.
Avec le recul, je me dis que nous aurions dû rester à l’abri (tout relatif) dans nos chars et attendre que les fantassins amis qui attaquent dans les collines à notre gauche arrivent à notre hauteur. Au lieu de cela, pour apprécier la situation et voir comment nous pourrions encore être utiles, nous avons mis pied à terre. Nous nous concertions, accroupis à l’arrière du char, lorsque je suis touché par une balle qui pénètre du côté droit à la hauteur de la hanche et sort à quelques millimètres de la colonne vertébrale. J’urine pour vérifier le bon fonctionnement du rein — ça marche ! La colonne ne semble pas touchée, ni la hanche ; je ne ressens qu’une légère brûlure.
Mon chef de char (qui n’est plus Belzic, affecté au 4e escadron) s’inquiète de mon sort lorsqu’il reçoit une balle en pleine poitrine et s’en va s’affaler dans le sillon boueux formé par le char. Il semble souffrir, je l’entends râler puis son souffle diminue, n’est plus perceptible. Je le crois mort jusqu’à ce que je l’entende à nouveau râler. Nous ne pouvons évidemment pas nous entraider car les balles nous obligent à rester allongés.
Cette situation s’est prolongée plusieurs heures jusqu’au moment où des jeeps (à moins que ce ne soit des half-tracks ou des scout-cars), profitant d’une accalmie, viennent récupérer les blessés pour nous amener au premier poste de secours. Le toubib du régiment qui m’ausculte me dit :
— Tu as du pot, apparemment la balle qui a traversé la chair sur une vingtaine de centimètres n’a rien touché de vital.
Sans avoir été très inquiet, je respire tout de même un peu mieux. Je remets ma combinaison. on m’allonge sur un brancard et c’est dans la position du tireur couché, c’est-à-dire sur le ventre, que j’arrive à l’ambulance chirurgicale.
Des médecins s’affairent auprès des nouveaux arrivants pour repérer les blessés nécessitant une intervention d’urgence. On s’intéresse à moi lorsque je montre la large tâche de sang à hauteur des reins en précisant qu’il s’agit d’une balle, mais je m’empresse d’ajouter que si je m’en rapporte au diagnostic du docteur des fusiliers marins, il n’y a pas urgence et on passe à un autre blessé. C’est à ce moment que je retrouve Germaine SABLON qui accompagne les médecins et je l’interpelle :
— Alors, vous ne me reconnaissez pas ?
Je n’ai pas dû lui faire grosse impression car je dois lui préciser :
— Vous vous rappelez, l’autre jour à Albanova ? Le fusilier marin conducteur de char, eh bien me voilà ! Ah, mon petit, où avez-vous été blessé ? Vous ne souffrez pas ? On va bien s’occuper de vous .
Me voici dans un bon lit — sous une tente. Seul le bruit de l’artillerie me rappelle la proximité du front. Après avoir un peu récupéré, je me renseigne sur le débarquement et l’attaque sur le front russe qui nous avaient été annoncés. Mais rien. Je suis un peu déçu, mais tellement heureux d’être encore en vie. À noter que mon chef de char s’en est tiré et que LEDET, mon aide chauffeur, a lui aussi été blessé par balle, au bras.
Ainsi donc sur les quatre membres de l’équipage, trois sont blessés et il en est ainsi pour la plupart des chars qui se trouvaient dans notre secteur. Il faut croire tout de même que pour avoir pénétré en profondeur au-delà de nos lignes l’opération que nous avons menée n’était pas sans intérêt. C’est ainsi que dans son livre La 1e D.F.L. – Les Français au combat le général Yves GRAS a pu écrire À l’escadron BARBEROT (le mien) la moitié de l’effectif est hors de combat. Mais leur attaque est, avec la prise du Faïto par le 8e R.T.M., le seul succès de ce premier assaut.
Je suis resté deux jours à l’ambulance chirurgicale et Germaine Sablon est venue à plusieurs reprises me rendre visite ; puis elle m’a annoncé que j’allais être conduit à l’arrière pour laisser la place à de nouveaux blessés.
J’ai donc été évacué sur Caserte (je ne suis pas sûr du nom de la ville) et je n’ai plus eu de nouvelles de Germaine SABLON sinon celles qui me sont parvenues par voie de presse. Il faut dire que je n’ai rien fait pour cela. Peut-être aurais-je dû la remercier ? Il est vrai qu’à cette époque nous avions pris quelque liberté avec la civilisation ! Je suis dans un hôpital américain et je dois avoir la peau bien tannée puisque l’aumônier catholique s’adresse à moi en me disant Mahomet ? , provoquant l’hilarité de ses compatriotes, mes voisins de chambrée. Il faut préciser que nous avions beaucoup de musulmans parmi les soldats du corps expéditionnaire français en Italie. C’était le cas de mon voisin de lit qui n’aurait pas survécu à ses blessures. Au bout de quelques jours, avec un peu de gîte à tribord du fait de ma blessure, je peux rendre visite à des camarades plus touchés que moi. Les soins et l’hygiène sont excellents, par contre la nourriture où alternent sucré et salé me paraît bizarre !
Mais je n’ai guère le temps de m’adapter aux nourritures d’outre-Atlantique en effet, fin mai nous recevons la visite du commandant BARBEROT notre chef d’escadron. Avec un certain humour , il nous dit qu’on s’amuse là-haut et qu’on nous y attend. Au lieu de prétendre à une convalescence, je me suis laissé embobiner et c’est ainsi que le 6 juin, jour du débarquement en Normandie, avec des pansements sur ma blessure, j’ai réintégré mon unité dans les environs du lac BOLSENA. En y arrivant, j’apprenais qu’un de nos chars venait d’être détruit et ses quatre occupants tués, parmi lesquels mon camarade Léon BIRMAN, mon pourvoyeur de Bir Hakeim.
On me confie la conduite du char de l’enseigne de vaisseau GOERE . Je me préparais, sans passion, à de nouveaux affrontements lorsque nous avons été informés que notre division allait abandonner la poursuite de l’ennemi sur le front italien. Nous campons dans un château dans la région de Castel Giorgio et de là je peux aller à Rome ; visite éclair à Saint-Pierre, mais il y a tant de choses à voir qu’il est difficile de faire un choix. Je crois tout de même me rappeler qu’avec mes camarades nous avions été voir sur la place de Venise le balcon d’où Mussolini vociférait à l’adresse de ses partisans.
Fin juin, nous embarquons à Anzio sur des chalands de débarquement pour Naples et nous nous retrouvons dans les environs d’ Albanova d’où nous étions partis quelques semaines plus tôt.
Malheureusement, des camarades ne sont plus avec nous, soit qu’ils aient été tués soit qu’ils aient été gravement blessés et évacués sur des hôpitaux en Afrique du Nord. À l’occasion de ce nouveau séjour à Albanova, j’ai pu visiter les ruines de Pompéi dont j’avais sans doute appris au collège l’ensevelissement sous les cendres et les laves du Vésuve.
Trois souvenirs de cette période me reviennent en mémoire : Nous avons eu la visite du général DE GAULLE . Nous nous sommes rendus en camion sur le terrain d’aviation où il avait atterri. Au retour, lorsque nous traversions des villages, certains parmi nous, sans doute par réaction au fascisme, chantaient l’Internationale. N’ayant jamais eu d’attirance pour le régime de Moscou, je me souviens d’avoir essayé d’obtenir le silence mais sans résultat.
Il est vrai qu’alors l’U.R.S.S. était notre allié et l’on disait de Staline qu’il était le petit père des peuples . Ce n’est que bien plus tard que l’on apprendra que le communisme d’U.R.S.S., sur le plan de l’horreur, avait été au moins l’égal du nazisme d’Hitler.
Nous nous sommes rendus au cimetière où avait été enterré notre pacha AMYOT D’INVILLE qui a sauté sur une mine le 10 juin. Pendant la minute de silence je m’aperçois que je suis devant la tombe de mon ami Pierre RAGUENES du Conquet, canonnier dans un de nos chars.
Pierrot avait un appétit féroce et je le voyais, en Tunisie, avaler d’épaisses tranches de pain recouvertes de poudre de chocolat tandis qu’il me disait : Ah Yves, vivement qu’on arrive à la maison pour manger du Kig ha Farz (plat typiquement léonard) et il ajoutait d’un air gourmand : Et avec du Lipic (beurre fondu) .
J’ai lu le nom de mon camarade sur le monument aux morts du Conquet et j’espère qu’il a trouvé du Kig ha Farz avec du Lipic au paradis du Bon Dieu.
Au cours d’une cérémonie au régiment, la croix de guerre a été remise à ceux qui avaient été blessés pendant la campagne d’Italie. La motivation, en ce qui me concerne, ne me paraissait pas suffisante, j’aurais aimé en effet que l’on me décore non pour avoir été blessé mais pour les quatre ans que je venais de passer aux fusiliers marins (j’étais devenu un des doyens de notre unité). Aussi, en faisant demi-tour, avant de rejoindre mes camarades, j’ai mis la croix de guerre dans ma poche. Était-ce une réaction de dépit ou d’orgueil, je ne sais, pourtant je n’étais pas sans savoir que dans l’armée, la hiérarchie est également respectée pour l’attribution des récompenses.
C’est ainsi qu’après Bir Hakeim les sans grades de notre pièce de Bofors avaient été récompensés par l’attribution de la médaille militaire avec croix de guerre à Le GOFFIC notre chef de batterie et de la croix de guerre avec palme au chef de pièce BELZIC , décorations bien méritées d’ailleurs.
Vers le 20 juillet, nous embarquons nos chars sur chemin de fer et en route pour les environs de Brindisi .
Il fait une chaleur torride et dans un site qui nous rappelle le désert nous waterproofons nos engins, c’est-à-dire que nous étalons une bande de toile enduite de graisse sur tous les orifices par lesquels l’eau pourrait rentrer dans le char. Ce dispositif est complété par une espèce de tuyère que l’on adapte au-dessus du moteur. Ainsi équipés, après que l’équipage est rentré par les panneaux supérieurs et ceux-ci fermés, nous devons pouvoir naviguer sous deux mètres d’eau. Nous allons donc participer à une opération amphibie. En France ? Dans le Nord de l’Italie ? On verra bien.
Sur le Liberty ship qui doit nous amener à Tarente puis à notre destination finale, nous vivons dans des conditions d’inconfort jamais égalées. Nous dormons dans des couchettes superposées à cinq ou six niveaux fixées en six rangées, de part et d’autre des panneaux de cale. Le moins que l’on puisse dire est que l’air est confiné lorsqu’il faut fermer les orifices pour assurer le black-out.
À Tarente nous rejoignons une véritable armada. Nous y passons quelques jours en rade puis nous appareillons vers notre nouvel objectif qui pourrait être le Sud de la France. Sur le pont le soir, la radio de bord donne les informations : les Alliés avancent partout, cela nous réjouit mais je ne puis m’empêcher de penser à nos chars waterproofés en fond de cale qui nous laissent présager un atterrissage périlleux au pays , notre objectif depuis si longtemps. Sur le bateau certains d’entre nous ont écrit à leur famille : je vois encore Le GOFFIC, , devenu officier des équipages, me montrer la lettre qu’il destinait aux siens en m’encourageant à en faire autant : je n’en ai rien fait. Je ne sais pas si la lettre de Le GOFFIC est parvenue à destination, mais lui n’est jamais arrivé à la maison puisqu’il a été tué dans son char le 22 août, entre Hyères et Toulon.
Le 16 août, après cinquante mois, je découvre à nouveau la France dans la rade de Cavalaire. Il y règne une grosse activité, apparemment la côte a été dégagée avant que nous n’arrivions et il me semble que nous n’aurons pas trop de difficultés à débarquer.
SOURCE BIBLIOGRAPHIQUE
Edition : Ville de Rennes – DIrection générale de la communication
Conception et mise en page ; Sutdio Bigot
Collaboration rédactionnelle : Sonia Crenn
Coordination éditoriale : Gilbert Lebrun
Imprimé par Chat Noir Impressions avril 2010





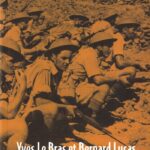

Laisser un commentaire