*LA PRISE DU GIROFANO : TU T’ES TROMPÉ D’OBJECTIF !
L’attaque avait été déclenchée trois nuits plus tôt, à 23h30.
Depuis ce moment, les compagnies d’infanterie progressaient péniblement dans ces arides montagnes d’Italie, recevaient des obus de canons ou de mortiers qui leur tuaient ou blessaient inutilement des hommes, perdaient la provision d’eau pour la journée…
Des équipes de brancardiers allaient et venaient, à la pêche aux blessés, civière vide dans un sens, chargée dans l’autre. Des tirailleurs enterraient les premiers morts de cette grande offensive du 11 mai 1944, dont l’objectif initial était le franchissement du Garigliano, et le second, plus lointain, la libération de Rome.
À la fin de la deuxième journée, la situation était des plus confuses. Au niveau des chefs de section, on ne savait pas grand-chose, mais moi, modeste sous-lieutenant, chef d’une section de fusiliers-voltigeurs, c’est-à-dire de ces sortes de combattants qui avancent, la mitraillette et la grenade à la main, à la rencontre d’autres types comme eux qui font exactement le même boulot, mais dans l’autre sens, moi j’avais au moins une certitude : j’étais parti à l’attaque, le 11 mai à 23h30, avec quarante hommes. J’en avais perdu trois ici, quatre là, et celui-ci au fond d’un ravin, et cet autre au sommet d’une crête, et aussi ces huit autres que des obus français m’avaient démolis, dans un tir d’arrêt trop vite et trop bien exécuté.
Si bien qu’il me restait à peine la moitié de ma section quand je reçus, par l’intermédiaire de l’aspirant BOUCHARD, l’ordre de m’installer pour la nuit sur une contre-pente, en attendant de reprendre l’attaque.
Ce serait peut-être notre première nuit de repos depuis trois jours. Les hommes titubaient de fatigue, de sommeil et de soif, et ne touchaient guère aux rations K, trop concentrées pour être consommées sans boisson, alors que l’eau était sévèrement rationnée.
Si tu crois dormir plus d’une heure ou deux, me dit BOUCHARD , tu te fais des illusions. Rends-toi compte : il faudra au moins une heure pour arriver au ravin en question. Ensuite, tu enverras des corvées de ravitaillement au P.C. du bataillon pour percevoir les vivres, grenades, cartouches, et aussi de la flotte. En mettant les choses au mieux, la distribution générale sera terminée à dix ou onze heures, et on devra sans doute faire mouvement vers deux heures du matin, pour s’installer avant le jour sur la nouvelle base de départ. Fais le calcul.
Bouchard ne s’était pas trompé : compte tenu de ce programme, qui fut étonnamment appliqué, j’eus, comme mes hommes, à peine le temps de dormir une heure, sur une pente abrupte où il me fallut caler mes reins contre un bloc de rocher pour ne pas rouler au fond du ravin, quand l’ordre me parvint de repartir.
Laissant sur sa gauche un autre bataillon de la Division – qui avait perdu la veille les deux tiers de ses officiers dans une attaque très dure – la 2e compagnie se mit à dévaler, prudemment, dans la nuit, une côte boisée et touffue qui sentait le charbon de bois, souvenir de l’incendie allumé la veille par d’innombrables obus, américains, français ou allemands.
Peu à peu, le jour se levait. Mais à mesure que les tirailleurs émergeaient de la nuit, le danger s’avérait plus grand, car les taillis, calcinés ou intacts, dissimulaient l’ennemi comme dans une forêt vierge. Au départ, j’avais émis la prétention de disposer ma section en triangle, pointe en avant. Or, le règlement est une chose, la guerre en est une autre, et c’est toujours le terrain qui commande. Il ne fut bientôt plus question de formation. Les ronces et les broussailles s’épaississaient de plus en plus, et les hommes de tête devaient même, le plus souvent, se frayer un chemin avec leur coupe-coupe.
** TIREURS D’ELITE
Ceux-là avaient la tâche la plus dure : pour ouvrir le passage, et pour guetter l’ennemi, tout près, derrière ce buisson, tapi dans ce taillis…
La campagne d’Italie, c’était à la fois une guerre de djebels et une guerre de forêt vierge, selon le jour et l’endroit, et les types d’en face étaient les maîtres du camouflage, du tir à tuer par une balle au front, de la mine antipersonnel qui explosait parce qu’un pied s’était pris dans un fil invisible, car comment voir un fil de couleur neutre dans cet inextricable fouillis de branches, de ronces, de lianes comparables à celles de la sylve africaine ?
Sans en avoir reçu l’ordre, les Saras se sont transformés en buissons, en recouvrant leur casque de feuillages. Les nerfs à fleur de peau, les sens aiguisés au centuple, ils avancent lentement, silencieusement, comme des reptiles ou des félins. Le moindre vol d’oiseau les plaque au sol, l’œil et l’oreille aux aguets, la détente souple sous un index merveilleusement huilé. Course au coup d’œil, au sang-froid, duel dont l’enjeu est la vie d’un homme contre la vie d’un homme.
Ta… Koohh !
Avec un miaulement rageur, la balle vient de me manquer et se perd dans la verte nature. Mais NOTENA le géant – un Sara plus grand que les autres Saras qui sont pourtant la race la plus grande du monde – Notena a vu l’Allemand au moment où il a tiré, et il a tiré en même temps. Il n’en a pas fallu davantage pour dévier un tir bien ajusté, et le tueur a été abattu dans un cri étouffé qui se transforme en râle : aaahhh !
II était à peine à huit mètres, et maintenant le voilà, dérisoire pantin détraqué au travers de la piste. En passant au-dessus de lui, je croise son regard vitreux, dans un visage très jeune, vingt ans tout au plus. Des yeux bleus, des cheveux blonds coupés en brosse, un casque inutile qui est tombé à côté de lui. Un gosse d’Allemagne qui, en un autre temps, aurait fait du tourisme en moto sur la Côte d’Azur et aurait fait admirer son corps de jeune athlète pur Aryen aux jolies Provençales.
Ce jeune et beau garçon a voulu me tuer, moi, personnellement qu’il ne connaissait pas, et NOTENA a tué le beau garçon, que maintenant les tirailleurs noirs de ma section enjambent avec indifférence, l’un après l’autre, sans regarder le mort car il a sûrement des copains, tout autour, encore bien vivants et placés là pour tuer.
Mais non, le petit Allemand devait être tout seul, placé par son officier en snipper isolé – c’était courant, chez eux – ou tireur d’élite, et c’est vrai qu’il tirait bien, le bougre, pour retarder l’avance des troupes françaises.
Car plus rien ne se manifeste pendant une heure ou deux de cette promenade épuisante, et la section arrive sur la crête intermédiaire, émergeant de la forêt. La guerre est passée là : il y avait une position ennemie, des abris de mitrailleuses, une pièce de mortier, des éléments de tranchée. Maintenant, il n’y a plus que du sol labouré, des arbres déchiquetés, des buissons incendiés, et six ou sept cadavres vert-de-gris. C’est le résultat d’un tir d’artillerie bien ajusté, qui a dû contraindre les survivants à se replier.
Il est neuf heures du matin. La 3e section, sous les ordres de ladjudant-chef Delpech, s’installe défensivement à droite de la mienne. La deux, commandée par l’aspirant LEMARINEL , est en réserve, derrière, et voici tout d’un coup le capitaine SICARD, qui souffle comme un phoque sans oublier de se gratter le nez :
Alors GRANIER, ça peut aller ?
— Comme vous voyez, mon capitaine. À part qu’on n’a pas d’ordres, et qu’on ne sait plus où on est, si on l’a jamais su…
— C’est-à-dire… enfin… j’ai reçu un message radio : il se confirme qu’on doit continuer dans cette direction, vers ce piton…
Je regarde au-dessus de ma tête. Le piton en question, en fait, c’est une longue muraille, limitée sur sa droite par une sorte d’à-pic, et qui se poursuit à gauche par une crête rocheuse aiguë, longue de plusieurs centaines de mètres. Il faudrait donc savoir si l’objectif de la compagnie est la droite, la gauche ou le centre de cette barrière. J’en fais la remarque à Sicard, qui ne me répond pas car il est déjà reparti, et bientôt la 1e section se retrouve toute seule, dans ce massif recouvert d’une intense végétation. Nous sommes maintenant sur une sorte de crête, dominée par d’autres crêtes dont la plus haute, droit devant, est vraisemblablement le Girofano, s’il faut en croire la carte au 1/50 000e..
** UN PITON PRESQUE VERTICAL
Après une autre descente dans des fourrés tout aussi épais que les précédents, puis un autre ravin, étroit, escarpé, où les hommes se sentent délicieusement bien, à l’ombre, sans Allemands ni obus, une courte pause s’avère nécessaire. Mais tout soudain un grand diable d’aspirant surgit des broussailles, sur ma droite. Nue tête, la mâchoire volontaire, l’œil bleu, la chemise largement échancrée sur une poitrine d’athlète, c’est TRIPIER qui commande la section de base de la 1e compagnie. Un gars extrêmement sympathique, que tout le monde aime bien dans le bataillon.
Salut, GRANIER. Qu’est-ce que tu as, comme objectif ?
— Le Girofano, et toi ?
— Moi aussi. Mais le Girofano, c’est grand : un vrai mur. Il paraît que les Marocains l’attaquent par la gauche, et nous par la droite. On n’en sait pas plus.
— Écoute, TRIPIER, lui dis-je, on pourrait s’entendre, nous deux : comme ta compagnie est à droite, tu pourrais ratisser tout ce qui est à droite de cet éperon rocheux qui précède immédiate ment le sommet… Tu vois ? Bon. Et moi je prends la gauche et on tâche, toi et moi, de garder la liaison.
— D’accord, vieux.
Deux sections du 24e Bataillon de Marche, réduites aux deux tiers de leurs effectifs, soit à peu près cinquante hommes au maximum, partent alors à l’attaque du Monte Girofano. Un sous-lieutenant et un aspirant, quarante-trois ans à eux deux, qui font tout seuls leur guerre, sans ordres plus précis, sans radio, sans liaison ni appui d’artillerie.
Crevés par trois jours de marche et de combat et par quatre nuits sans sommeil, les hommes blancs, les hommes noirs, montent, grimpent, escaladent les rochers du Monte Girofano. Presque aussitôt après avoir quitté le ravin, il leur faut s’agripper des mains, sans lâcher pour autant le fusil, la mitraillette ou le fusil-mitrailleur. Et aussi les grenades et le coupe-coupe, fidèle compagnon de ces Africains, encore un tantinet sauvages qui n’oublient pas leur arme ancestrale, même si l’homme blanc les a dotés d’armes automatiques tirant à une cadence rapide.
La paroi est tellement verticale que les tirailleurs se sentent en sécurité : nul obus de mortier, nul coup de fusil, nulle rafale de mitrailleuse ne peut les atteindre. Pourvu que ça dure…
Pourvu que ça dure. Ce n’est pas croyable ce que ça peut revenir souvent, dans la bouche ou dans l’esprit du fantassin, cette petite phrase. Tu es dans un ravin, à roupiller comme une bête, entre deux déplacements : pourvu que ça dure. Tu as trouvé un trou, un petit trou de rien du tout, à peine assez profond pour permettre à ton corps, aplati au maximum, d’être à l’abri des rafales rasantes et des éclats vicieux de mortiers : pourvu que ça dure. Tu grimpes une falaise à l’abri des vues et des coups, pourvu que ça dure…
Mais quand même, elle n’est pas interminable, cette muraille du Girofano, et voici le sommet, où l’on pourrait souffler si des tireurs allemands ne vous y attendaient. Sur cette montagne, deux jours plus tôt, un bataillon de Marocains, a été trompé par une ruse chère aux Allemands, en 14-18 : ils ont crié Kama-rad ! , les Marocains ont donné dans le panneau, se sont avancés à découvert, et les types d’en face, contents de leur bonne blague, sans doute, les ont flingues à bout portant au lance-flammes. Cela, les hommes du Tchad le savent déjà, bien qu’ils n’aient aucun rapport avec ces autres soldats français que sont les tirailleurs marocains. Mais les nouvelles vont vite, dans une armée en campagne, même si les uns parlent arabe, les autres, sara ou bambara..
** L’ASSAUT DES TIRAILLEURS
Un mètre après l’autre, nos deux sections s’approchent du sommet, calciné par les éclatements de l’artillerie qui, depuis la veille, pilonne sans arrêt l’infernal pain de sucre.
Les bidons sont vides, les bouches sont sèches, mais les hommes ont dépassé la soif comme ils ont dépassé la fatigue et la peur. Aucune force au monde, sauf la mort, ne peut les arrêter. Des robots qui avancent, mais des robots qui deviennent soudain furieux car les dés sont jetés, et qui ont compris que, maintenant, le seul salut est de coller au barrage d’artillerie, aux obus français que les canonniers de la Division font pleuvoir sur ce sacré piton.
Car ces minuscules fourmis sur fond de roches claires, ces insectes sombres qui montent presque à la verticale, un observateur invisible, dans un piper-cub ou sur un autre piton, les a vus, situés, a défini leurs coordonnées. Mieux que Tripier et que moi-même, il sait que nous approchons du sommet, donc que nous allons donner l’assaut. Alors, voici que les canons se taisent et que s’établit un surprenant silence – merci à toi, l’artilleur inconnu, pour ton signal parfaitement compréhensible ! – et que ce silence est aussitôt troublé par le cri rauque que je m’entends pousser, et qui est répercuté, sur ma droite, par celui de TRIPIER :
— En avant !
— En avant ! !
Le fusil dans une main, le coupe-coupe dans l’autre, poussant des hurlements, l’œil injecté de sang, les dents éclatantes de blancheur dans des faces grimaçantes, le casque anglais bizarrement rejeté en arrière, objet inutile et dérisoire, mais rassurant comme un grigri, ces grands diables de Noirs du Tchad aux profonds tatouages donnent l’assaut du Monte Girofano, démons d’un autre monde, d’un autre siècle.
Et les voilà tout de suite débouchant sur une sorte de plateau chaotique, serrant comme leur père le jeune sous-lieutenant, que seule la couleur de sa peau distingue de ses hommes.
Éclatements de grenades. Rafales de mitraillettes. Hurlements forcenés, cris de douleur, gémissements…
En face, des hommes vêtus de vert-de-gris émergent de leurs casemates et de leurs rochers, et se ruent à la rencontre de ma section, ou de ce qu’il en reste, car beaucoup sont tombés. Encore des éclatements de grenades, encore de sèches rafales qui claquent dans les jambes, percent des poitrines. D’autres hommes tombent, tirailleurs saras ou soldats allemands dont certains allaient peut-être se rendre mais qui n’ont pas de chance. Et toujours des cris, des ordres en français ou en allemand, des relents de poudre, de sueur, de sang. C’est déjà fini.
L’assaut n’a pas duré cinq minutes, semble-t-il. Des Allemands jettent leur casque à terre, débouclent en hâte leur ceinturon en criant :
— Kamarad ! Kamarad ! Nicht kapout !
L’un après l’autre, les blockhaus et les abris sont fouillés. D’autres hommes harassés, sales, barbus, encore hébétés par le pilonnage de l’artillerie du Corps Expéditionnaire sortent, un par un, les mains en l’air, nue tête, sans arme et sans ceinturon.
À quelques mètres en contrebas, quelqu’un m’appelle :
— GRANIER ! Ça va ?
C’est TRIPIER , aussi heureux que moi, parce qu’il vient lui aussi de gagner une bataille, sinon la guerre. Et nous nous saluons joyeusement, lui et moi, du geste classique du boxeur qui a gagné un match.
Puis j’avance sur le plateau, suivi de GOTTINGAR et de quelques tirailleurs, pour finir le nettoyage.
Soudain, des cris, des appels effrayés sortent d’un orifice sombre :
— Kamarad !… Nicht kapout ! Austria !
D’après les voix, ils doivent être trois ou quatre là-dedans, autrichiens ou pas. Je leur parle en italien, langue qu’ils doivent comprendre, depuis le temps qu’ils sont sur la péninsule. Je leur dis :
— Ça va vous pouvez sortir, elle est finie la guerre pour vous, on ne vous tuera pas…
J’attends, près de l’entrée du blockhaus, le doigt sur la détente de mon Tommy Gun, quand même. En face de moi, de l’autre côté de l’ouverture, GOTTINGAR, dans la même position, attend. Et les tirailleurs attendent aussi, tout près. Des rochers nous dissimulent en partie, surtout vers la droite, où d’autres tirailleurs tirent des rafales sporadiques.
Un instant se passe. Les prétendus autrichiens ne veulent pas sortir, et continuent de supplier qu’on ne les tue pas. Bien sûr qu’on ne les tuera pas, je le leur confirme.
Ils se décident alors, et sortent, hagards, hésitants ; le premier porte une courte moustache et des lunettes. Il a l’air d’un professeur. Un soldat, deux, trois, quatre sortent ; tous ont l’air de braves types et déjà, dans leurs yeux, l’expression de soulagement du réserviste pour qui, désormais, la guerre est terminée…
C’est vrai qu’ils ont l’air de braves types, vus de près, à bout portant du regard, celui-ci avec sa moustache, celui-là avec ses lunettes, cet autre avec ses oreilles décollées et ses taches de rousseur. Des hommes comme nous. De toute évidence, ces soldats allemands, ou autrichiens, s’il faut les en croire, ne sont pas des SS, mais plus probablement de tranquilles réservistes qui se sont trouvés là, sur ce piton des Apennins, parce que leur commandement les y a obligés. Mais ils préféreraient sans doute être chez eux, aux côtés d’une épouse dodue qui sait si bien leur mitonner une bonne choucroute.
Et ces grands diables noirs du Tchad, avec leur coupe-coupe à la main, leur mitraillette encore fumante et leur casque anglais, posé de guingois sur l’arrière du crâne, eux non plus finalement, ne sont pas de mauvais bougres, si on sait stopper à temps l’élan meurtrier qu’on leur a inculqué avant l’attaque.
Qui donc a dit : La guerre est faite par des gens qui se tuent et ne se connaissent pas. Elle est décidée par des gens qui se connaissent et ne la font pas ?
Cinquante ans sont passés, au moment où j’écris ces lignes, évoquant des souvenirs toujours vivaces, en dépit de ce demi-siècle écoulé. Nos ennemis d’hier sont devenus nos amis, comme le prévoyait un colonel allemand qui devait m’interroger un peu plus tard, dans un donjon médiéval où j’aurai la mauvaise fortune d’effectuer un séjour forcé, dû aux aléas de la guerre…
Et mes braves tirailleurs, que sont-ils devenus ? Ceux que les combats de France ou d’ailleurs auront épargnés ?
** CE CON, QU’EST-CE QU’IL FOUT LÀ-HAUT ?
Debout sur le rocher le plus haut, mon Tommy Gun pendant au bout de mon bras, je contemple d’un regard absent ces cadavres à mes pieds. Cadavres à face noire en kaki, cadavres à face blanche en vert-de-gris, et cette position que je viens de prendre, moi, modeste sous-lieutenant d’Infanterie de Marine. Ma première victoire personnelle de jeune chef. Mais le bilan est lourd.
D’une section de quarante hommes l’avant-veille, il m’en reste moins de vingt. En contrebas, adossés à des rochers, trente ou trente-cinq prisonniers, comme un bétail parqué, attendent leur évacuation vers un endroit inconnu, dont ils savent seulement que ce sera à l’arrière et loin d’un champ de bataille.
Mais voici que revient BOUCHARD , sorti on ne sait d’où, une fois de plus :
— Dis donc, GRANIER , il paraît que tu t’es gouré ! Ce piton, c’était pas ton objectif !
— Qu’est-ce que tu racontes ?
— Oui. Un officier supérieur, que je ne te nommerai pas (mais tu vois de qui je parle), a dit : Ce con, qu’est-ce qu’il fout là- haut ? Ce n’est pas son objectif ! Mais le général est vachement content. Il vient de féliciter le type en question. Bon. C’est pas tout ça, faut que je me tire…
BOUCHARD disparaît de nouveau, en me laissant méditer sur cette très vieille constatation, dans l’armée comme dans le civil, qui dit qu’on est toujours récompensé dans la personne de ses chefs.
Je quitte mon rocher comme à regret. Un rocher où j’aurais bien planté un drapeau, si j’en avais eu un, et même si ledit rocher n’était pas dans mon objectif. Très loin en contrebas, j’aperçois une plaine riante et fertile, contrastant de façon saisissante avec la rocaille où nous crapautons depuis des jours.
C’est alors qu’une grenade éclate dans mes jambes, et me voilà par terre, au pied d’un buisson. Une vive douleur m’empêche de bouger, et je sens un liquide chaud couler dans mon pantalon.
METROT , qui poursuivait le nettoyage de la position à quelques mètres de là, se précipite :
— Mon lieutenant, vous êtes blessé ?
J’ai un sourire un peu bête :
— Oui, mon vieux, j’en ai pris dans la patte. C’est con, on en avait presque terminé…
Aidé de NOTENA, qui a l’air désolé, METROT me traîne à l’abri d’un buisson rabougri, par mesure de précaution.
— NOTENA s’occupera de moi, dis-je à mon adjoint. Vous, METROT , prenez le commandement de la section et attention à la contre-attaque. Gardez-vous bien de tous les côtés.
METROT s’en retourne vers les tirailleurs. Je le regarde affectueusement, en pensant que c’est un gars très bien, ce petit sergent-chef, avec ses taches de rousseur et son accent de Châteauroux. Un type solide, sur qui on peut compter, un de ces bons sous-officiers de la Coloniale que les armées étrangères nous enviaient, jadis…
Une large flaque de sang s’étale sous ma jambe gauche. Appelé par radio, un infirmier du bataillon arrive un peu plus tard sur le piton. Il déchire mon pantalon, et la cuisse apparaît, tellement tuméfiée et ensanglantée qu’on ne peut savoir s’il y a une blessure ou plusieurs. Je saurai plus tard que j’ai reçu ce 13 mai 1944 neuf éclats de grenade offensive, dont le plus gros a la taille d’une lentille.
L’infirmier n’en sait pas tant, ce jour-là, et me pose, un peu au jugé, deux ou trois paquets de pansement. Pas question de laver la plaie, ou les plaies, car il y a bien longtemps, un siècle semble-t-il, qu’on n’a pas vu une goutte d’eau dans cette section. De l’eau, il y en aura sûrement en bas, dans la vallée…
**LES LITS BLANCS DE L’HÔPITAL
Tard dans l’après-midi, une paire de brancardiers noirs m’emmena sur une civière cahotante. Il me fallut attendre d’être en bas du Girofano pour boire, enfin, ma première gorgée depuis la veille. JUGUET, le médecin-capitaine du bataillon, me tendit un bidon de café, qu’il dut m’arracher de force.
Juguet me fit ensuite une piqûre de morphine, et m’expédia au centre de ramassage divisionnaire, où je vis LAFUENTE, le toubib auxiliaire, qui retournait au P.C.
Tu es le troisième officier blessé aujourd’hui, dans le bataillon, me dit-il. FAVROT a eu une jambe cassée par un éclat d’obus, et Lebrun a sauté sur un bobby trap .
— C’est grave ?
— Pas trop ; il s’en tire avec une fracture ouverte, et des éclats un peu partout.
Comme les brancardiers repartaient, LAFUENTE revint vers moi :
— Tu sais que FAUROUX y est resté ?
— Fauroux ? Non, je ne le savais pas…
Au balancement cadencé de mes porteurs, et engourdi par l’effet de la morphine, je me répétais ces mots comme un leitmotiv : FAUROUX est mort… Nous ne verrons plus jamais ce grand type à la figure de gosse, qui riait et chantait, du matin au soir dans les cantonnements de Tripolitaine et de Tunisie. Dieu ! Qu’il chantait faux ! Nous ne l’entendrons plus jamais chanter faux le gars Fauroux, car le gars Fauroux est mort. Mort comme JEANNE , mort comme MERREAUX , mort comme bien d’autres qui tombent chaque jour…
*Poursuivre
- La Campagne d’Italie 1 – L’attaque du Garigliano, par Pierre Granier
- La campagne d’Italie – 3 – L’attaque de Torre Alfina, par Pierre Granier


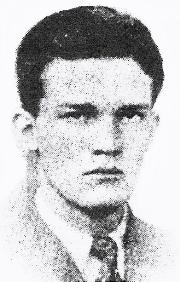




Laisser un commentaire